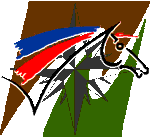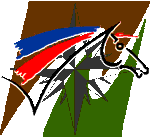Lâ« affaire Bartabas » offre lâoccasion de se pencher sur la réalité dâune école équestre unique au monde
Câest une «affaire» qui commence le 21 décembre dernier. Jean-François de Canchy, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) à Paris, convoquait Bartabas, fondateur de Zingaro, mais aussi de lâAcadémie du spectacle équestre de Versailles, afin dâévoquer la situation financiÚre préoccupante de cette derniÚre institution.
Cet été, un plan de « sauvetage » sur trois ans avait été mis au point, prévoyant une subvention de 350.000 ⬠versés par les diverses collectivités et lâÃtat, qui sâengageait lui-même à hauteur de 175.000 â¬. Or Jean-François de Canchy annonçait à Bartabas lâannulation de ce plan. Dans un subit mouvement de colÚre, Bartabas coupait court à la discussion, faisait voler les chaises, sâen prenait au mobilier.
Laissant le personnel de la Drac sous le choc, il regagnait la rue où, interpellé par la police, il était mis en garde à vue jusquâau lendemain matin. Indignée à juste titre par cet acte « inqualifiable », Christine Albanel, ministre de la culture, précisait quâune plainte avait été déposée et que la justice suivrait son cours. Ses services nâen déclaraient pas moins que lâannonce de la Drac était une erreur et que le plan de sauvetage était maintenu.
Une perte de 40% de son budget aurait signé la mort de lâAcadémie. Trois semaines aprÚs, Bartabas « justifie » toujours son attitude (« ce qui ne lâexcuse pas », reconnaît-il) par ce malentendu « qui aurait signifié la mort de lâAcadémie avec une perte de 40 % de son budget ».
Quel est le statut et la réalité de la situation de cette Académie unique en France, voire dans le monde, qui se présente autant comme une école formant au dressage de haute école et à lâart équestre que comme une « école de vie » ?
Une « compagnie école ». « Les écuyers qui sont ici, ne sont pas pour moi de simples élÚves, explique Bartabas. Ils arrivent avec 10 ou 15 ans dâéquitation derriÚre eux. Ce sont des artistes qui se perfectionnent sans cesse, tout en se confrontant au public à travers la représentation. »
Outre des exercices équestres, ils suivent des cours de danse, dâescrime, de chant, dâarts plastiques, de « kyudo » (le tir à lâarc japonais). Il ne sâagit pas, cependant, de transformer les douze écuyers de lâAcadémie en spécialistes de tous ces domaines, mais de « développer leur sentiment artistique ».
Lâidée directrice est celle de la « transmission », renouant avec lâesprit des ateliers de peintres dâautrefois, des Compagnons du Devoir ou, mieux, de lâécole de danse créée jadis par Béjart. Les écuyers forment une sorte de corps de ballet équestre capable de se produire aussi bien sous la gouverne de Bartabas que sous celle dâautres chorégraphes â il rêve dâun spectacle avec Pina Bausch.
Entrés comme élÚves, ils passent progressivement du statut de cavaliers confirmés à celui de titulaires («un peu comme les sociétaires de la Comédie-Française »). Ils peuvent rester sans limite au sein de lâAcadémie, formant à leur tour les nouveaux arrivants. Il nây a pas de diplÃŽme. Certains, notamment au ministÚre, sâen émeuvent. Pas Bartabas.
« Je veux bien faire comme les autres. Mais à quoi cela peut-il servir ? Les seuls diplÃŽmes qui existent dans le monde équestre sont ceux qui permettent de participer aux concours hippiques ou de devenir instructeurs. Moi, je forme des artistes. Il ne sâagit pas seulement de maîtriser une technique mais la relation qui unit un homme et un cheval. Câest sans fin. »
Un propos parfois difficile à admettre de la part des collectivités notamment lorsquâelles sont appelées à la rescousse pour financer lâAcadémie, alors que Bartabas sâétait engagé, à lâorigine, à ce que cette derniÚre sâautofinance. |